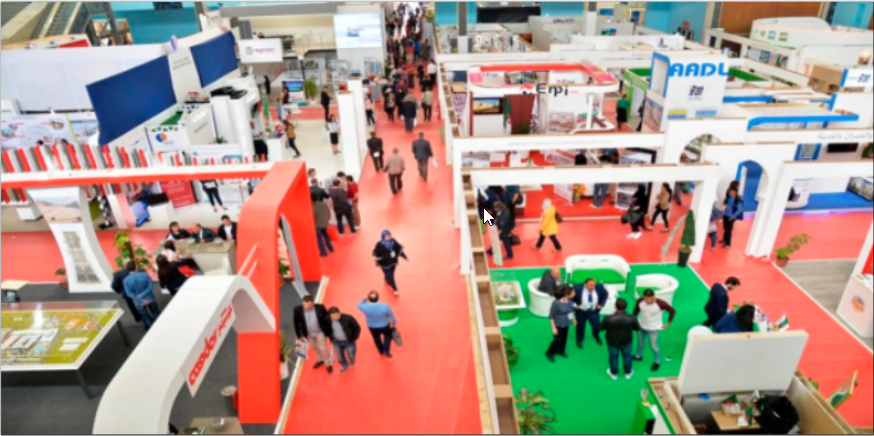Le rêve est gratuit
Ne m’en voulez pas…

Préambule
Peut-on dire que ce que j’écris dans ce texte est une véritable pièce de théâtre, classique, selon les normes requises dans ce genre de littérature ? Le lecteur sera seul juge. En tout cas, si elle n’en est pas une, j’aurai le mérite d’avoir essayé. Mon intention est de présenter quelque chose qui se tient, sur le plan du contenu, c’est-à-dire du message que je veux transmettre. Mon autre intention est de présenter quelque chose qui arrive à ce même lecteur dans un style accessible, facile à parcourir, afin qu’il ne puisse s’embarrasser de trop d’élocutions pour lesquelles il lui faudrait trimballer une encyclopédie de langue et de grammaire, pour en comprendre le sens et la dimension de cette tragédie qui se joue, hélas, sous nos yeux. Ce serait, de ma part, une marque d’égoïsme et une manifestation de pédanterie, que je ne devrais jamais afficher, eu égard à ce que je souhaite léguer à la jeunesse, surtout.
Voyez-vous jeune homme, de bonne famille, je ne suis pas là, dans ce théâtre pour aller dans le sens du bon vouloir des spectateurs. Comme je n’éprouve aucun plaisir à répéter continuellement les mêmes causes de notre sacré malaise, à savoir, la corruption, le vol et l’impuissance du pouvoir, du système ou de l’Etat, appelez-le comme vous voulez. Je suis là, dans ce théâtre pour, d’une part, raconter mon rêve en le jouant intégralement avec vous, et d’autre part, pour être fidèle au texte qui insiste sur tous ces aspects négatifs, afin qu’à notre réveil, nous prenions conscience de la gravité de la situation et allons d’un pas décidé entreprendre notre renaissance. Il est vrai que nous sommes en train de reproduire souvent les mêmes clichés, et quelquefois d’une façon désordonnée. D’autres diraient d’une façon lancinante. C’est le rêve qui se veut ainsi, de cette manière, une manière décousue et incohérente, pour rester dans l’illusion de ce courage éphémère qui vous donne la force de revenir, chaque fois, sur des sujets qui sollicitent votre indignation et votre condamnation. Mais il est vrai aussi que nous n’avons que ces problèmes, et uniquement ces problèmes, qui nous causent des préjudices parce que par ailleurs nous avons tout ce qui peut nous procurer cette joie de vivre et permettre à notre peuple d’évoluer constamment. Il faut donc en parler. Ainsi, n’est-il pas nécessaire de les réitérer devant vous, chaque fois que de besoin, pour crier notre exaspération, pour marquer le danger de telles expressions négatives dans notre pays et enfin pour sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes, autour de la nécessité de reprendre sérieusement la situation en main pour l’améliorer et arrimer notre pays aux locomotives puissantes de la modernité ? Ceci dit, laissez-moi retourner à mon gars, à celui qui parlait de banques pleines, de portes grandes ouvertes et de conclure : «pourquoi les voleurs demanderaient-ils l’autorisation pour se servir ?». Franchement, pensez-vous qu’avec une conviction pareille – la vôtre – nous pouvons avancer ? Vous n’avez vu que cet aspect : celui du vol et du profit ? Votre esprit n’a pas voyagé ailleurs pour prendre le meilleur exemple de droiture et de dévouement en admettant honnêtement que notre pays a produit, quand même, du concret, en une période où les gens se sentaient plus concernés par le développement et l’évolution. Oui, il faut le redire pour que les gens de votre «espèce» sachent que des légions de diplômés, de cadres supérieurs et de hauts techniciens occupaient (et occupent toujours) le terrain en faisant fonctionner nos institutions et nos structures économiques.
Ceux-là se mobilisaient résolument (et se mobilisent jusqu’à maintenant) pour le bien du peuple, dont vous faites partie et dont vous vous opposez apparemment à suivre ses bonnes traditions en vous soumettant à ses meilleures règles de vertu. Sinon… s’il n’y a pas ces hommes de bonne volonté, s’il n’y a pas de rendement, même minime, s’il n’y a pas la manne de Dieu – en sous-entendu les barils qui se transforment en pétrodollars –, notre pays serait détruit, après tout ce que nous avons enduré. Il aurait disparu à jamais, comme après un cataclysme mondial. C’est vrai qu’il y a un grand malaise chez nous, c’est vrai que certains responsables, pour ne pas dire la plupart, ne sont pas à leur place – nous en avons parlé et nous en reparlerons encore – mais c’est vrai aussi que l’État a fait ce qu’il a pu, vis-à-vis du peuple et de la jeunesse surtout. C’est alors que critiquer n’est pas interdit, dénoncer, comme nous le faisons présentement, est un acte de courage, une volonté de bien faire et une contribution concrète pour prévenir le mal, mais réfuter en bloc ce qui a été réalisé, c’est du travail de sape ! C’est pour cela que je dis qu’il est regrettable de ne pas trouver chez bon nombre de nos citoyens cet esprit de reconnaissance. «L’État ne nous a rien fait !» disent-ils, ou encore, «notre pays ne nous a rien donné»… Quelle ingratitude ! Oui, quelle ingratitude ! Cette image nous la trouvons même chez les gens modestes et leurs enfants – j’en ai déjà parlé – ceux qui ont profité de ce système, de ses générosités, et qui sont actuellement, pour leur bonheur et le nôtre d’ailleurs, médecins, ingénieurs, cadres supérieurs et autres chercheurs.
Mais au fait – et là je me fais encore l’avocat du diable –, n’ont-ils pas raison quelquefois ces ingrats de s’exprimer de la sorte, même quand ils vont dans la négation du passé ? Ma réponse, moi qui essayait, il y a un instant, de défendre le pouvoir et je n’ai pas tort, est qu’ils ont raison, en partie, parce qu’on leur a laissé la voie libre pour devenir ce qu’ils sont ? Il y a eu démission au niveau du pouvoir, c’est-à-dire au niveau des hommes qui le composent. Certains disent qu’il y a eu complicité. Mais les deux sont possibles dans la mesure où l’une et l’autre sont deux recettes, voire deux épreuves qui ont affaibli et gangrené le pays. C’est ainsi que la première réaction que nous pouvons avoir pendant que nous manifestons du dégoût aux dérisions et aux diatribes de nos «nouveaux riches» contre l’ancien et le nouveau régime – et l’un et l’autre leur ont pourtant permis d’être ce qu’ils sont aujourd’hui –, ressemble beaucoup plus à de l’amertume que nous reconnaissons en faisant notre autocritique, sans complaisance et sans hypocrisie. Nonobstant cette remarque qui n’est pas dénuée de bon sens et de tout regret, il est évident que l’on ne pourrait accepter facilement ces répliques insidieuses, tout à fait contraires à nos convictions.
Nous sommes obligés de nous arrêter à ces remarques désobligeantes et à ces comportements mafieux, et ne pas les sous-estimer afin de découvrir encore plus ce qu’il y a dans les esprits. Ainsi, faut-il revenir un peu en arrière et voir de plus près ce qui a été en partie la cause de nos problèmes d’aujourd’hui ? Il serait peut-être nécessaire de faire le constat. De l’autocritique responsable donc, il faut passer à l’auto réprobation. Et nous nous disons, avec amertume : fallait-il engager tout un processus de développement, pendant ces longues années, pour aboutir à des résultats de cette nature ? En d’autres termes, fallait-il se décarcasser pendant des décennies pour enregistrer des progrès considérables sur les plans économique, culturel et social et arriver, aujourd’hui, comme par hasard, à «bouffer» – comme la chatte mange ses enfants – ce que nous avons réalisé avec ferveur et ardeur ? Devrions-nous vivre de nihilisme et s’avouer vaincu devant des difficultés, certes importantes mais normales dans le cadre du tournant décisif que vit le pays ? Fallait-il faire tout cela quand la solution était là, d’après «certains», à portée de ceux-là mêmes qui n’avaient de cesse que s’instaurât dans notre pays une politique de bazar, une politique affriolante où l’on vit sur un grand pied et où les plus avertis parmi les spécialistes de l’économie, à l’intérieur comme à l’extérieur, ne saurait trouver leur logique ?
Ne serions-nous pas tenté, dans la lancée, de nous poser une autre question, peut-être plus gênante et plus insidieuse, c’est selon, pour sortir des sentiers battus et confirmer que ce qui nous arrive aujourd’hui nous a été planifié, il y a bien longtemps ? Effectivement, la situation au quotidien et la manière dont évoluent les choses nous contraignent à penser que rien n’est arrivé par hasard. Elles nous somment de mieux réfléchir pour savoir que nos fautes du passé se répercutent sur nous aujourd’hui, de même que nous devons comprendre d’une manière presque formelle que nous avons été également la cible de ceux qui nous préparait cette descente aux enfers et que nous avons eu enfin, d’après eux, la récompense que nous méritons. De là, nous pouvons être sûrs que nous sommes en train de vivre les affres du déséquilibre et de la prosternation. L’échelle des valeurs, nous l’avons dit, est renversée. Le responsable n’est plus ce responsable d’antan qui avait cette teneur de notoriété, et le citoyen, – ce pauvre tube digestif – a perdu le sens de sa citoyenneté dans les problèmes de tous les jours. Tenez, analysons notre environnement direct, avant même de laisser vagabonder notre esprit ailleurs, dans les grands problèmes économiques et de gestion qui actionnent notre développement.
Observons notre entourage immédiat, pour nous apercevoir du délabrement dans lequel nous nous enfonçons, sans rémission. Plusieurs raisons, en sont la cause. Mais commençons par le commencement… par les facteurs de nuisance qui ont produit notre malaise. L’autorité est inexistante. Quand elle existe, elle fonctionne à sens unique, au profit de ceux qui sont loin de répondre aux règles de l’éducation et de la morale. Les exemples sont nombreux et se multiplient au rythme de l’indélicatesse et de la déchéance. Les banques, pour ne citer que ces institutions, importantes et souveraines, n’attribuent de grands prêts qu’à ceux qui ont beaucoup de poids dans la hiérarchie du pouvoir ou à ceux qui savent répondre à leurs «largesses», en assurant ses responsables de substantiels dividendes. Nous en avons déjà parlé de cette mascarade qui n’existe nulle part au monde, sauf dans un pays comme le nôtre où le pouvoir persiste à se comporter comme dans une «République de singes». Ainsi, nous constatons que de grandes sociétés d’État, performantes ou en voie de l’être, n’ont pu bénéficier du strict minimum, en volume de prêt, alors que des entreprises privées, à peine constituées, se sont accaparées de tous les fonds qui se chiffraient à des centaines de millions de dollars. Également, de petits comptables, de petits gestionnaires ont eu ce privilège de monter, monter au firmament, grâce à ces prêts incompréhensibles et inaccessibles pour d’autres, et venir narguer l’État, ses institutions, ses commis honnêtes, en fait défier tout le système tout en se retournant contre lui. De là, l’échelle des valeurs est bousculée et l’équilibre est rompu, dans une société où les rapaces vivent ostensiblement dans la luxure et l’impunité. Quant aux ploucs, qui remplissent notre périmètre de survie, ils prolifèrent dangereusement comme des microbes.
Ceux-là, de par leur «culture» et leur ascendance, aiment vivre dans la boue, dans un décor insolite que ne peuvent accepter ceux qui vivent dans l’autre temps, celui du progrès et de la connaissance. En réalité, ces ploucs sont rattrapés par leur «pastoralité», au sens péjoratif, bien entendu. D’ailleurs, je l’écris entre guillemets, parce que la paysannerie est noble ; j’en suis convaincu, tout comme l’était l’Émir Abdelkader qui s’est exprimé à ce sujet, dans une remarquable poésie. Ainsi, ceux-là, dans le sens des «Aârabes», cités dans le Saint Coran et dans les écrits d’Ibn Khaldoun – ne pas confondre bien sûr avec les Arabes –, tiennent absolument à reproduire leur environnement dans ce qui fut la noble cité, aidés par les responsables qui, eux-mêmes, sont de la même espèce et ont les mêmes réflexes et les mêmes affinités. De là, je peux dire que la dégradation s’est opérée dans deux espaces, d’abord dans les esprits et a atteint les mœurs et les usages et, ensuite, dans la nature et a atteint tout ce qui concerne l’environnement. A ces mots, un homme élégant, remarquablement habillé, d’un âge respectable, lève sa main, comme pour intimer l’ordre à l’artiste d’interrompre sa tirade. Il s’avance d’un pas assuré et, d’une voix, aussi claire que patente, lui adresse : – Je vous attendais. Oui, je vous attendais sur ce problème d’environnement. Vous avez bien fait de l’évoquer, parce qu’il devient notre souci quotidien. Nous sommes d’autant plus malades, du fait que nous ne pouvons rien faire avec ceux-là mêmes qui l’ont voulu ainsi. Et j’ai assez de courage pour les dénoncer. L’environnement sale ne leur déplait pas, ne les dérange pas. Ils ne sont pas gênés, choqués ou scandalisés, comme le sont les citadins qui ont cette culture du beau et du parfait ou, à la limite, du raisonnable. Des talus où poussent des herbes folles et des orties, et où viennent se coller des sachets noirs, sont des paysages qu’ils affectionnent particulièrement.
Cela leur rappelle la campagne, «el bled et riht el bled», en d’autres termes, la gadoue et les relents qui leur arrivaient de la décharge, installée juste à côté de la mansarde où viennent picorer les gallinacés des vers de terre et entonner le chant du matin, en un orgueilleux cocorico. Mais tout cela reste très beau, très sain, dans un milieu rural, pour que l’on ne m’accuse pas de vouloir créer cette discrimination entre les gens de la ville et ceux de la campagne. Ce milieu reste un besoin et une nécessité pour le paysan qui respire de l’air frais, non pollué, un air qui lui donne plein de vigueur. Pas comme le nôtre, corrompu et vicié, qui nous donne des rhumatismes et de l’asthénie. L’artiste l’arrête, parce qu’il ne veut pas se voir impliquer dans un conflit de «régionalisme». Cette intervention est noble, elle est juste, mais il souhaite la continuer lui-même parce qu’il interprète un rêve, et il est le principal responsable des propos qu’il lance et, par voie de conséquences… de ses conséquences. Les autres n’ont pas le droit de se mouiller outre mesure parce qu’ils ne sont pas comptés dans le rêve, en tant qu’acteurs responsables. – Vous me voyez d’accord avec vous car, ceux-là, une fois dans la cité, ont oublié cette noblesse et ont fait de notre environnement un sujet de honte, pour les malheureux citoyens, comme nous, qui avons vécu ces anciens temps où nous ne savions pas cracher par terre, où nous ne pouvions pas jeter n’importe où nos ordures, où nous ne restions jamais deux à trois jours sans nous raser…
Le pays est devenu un grand dépotoir et le délabrement est partout ! Il n’existe aucun signe d’amélioration, malgré l’institution aménagée spécialement pour contrôler notre environnement, malgré les nombreuses commissions installées à cet effet et les vœux pieux qu’ils nous répandent à longueur d’année. Notre environnement s’amoche et se dégrade de plus en plus et nous nous enfonçons dans le pire, dans la merde, pour être direct… A voir les vues poignantes qui ne nous honorent pas, dans un pays qui, pourtant, faisait l’unanimité pour ses beaux paysages, son admirable netteté, ses magnifiques couleurs, son céleste oxygène et ses belles senteurs, nous ne pouvons que regretter ce passé récent où la propreté était notre vertu cardinale. Oui, mais en ce temps-là notre pays faisait sa mue et décollait assurément vers des horizons prospères. Ah, si El Mamoun était de notre temps ! Dans une déclaration à la presse, les responsables eux-mêmes affirment que plus d’un millier de lotissements et de coopératives de la capitale (seulement la capitale, alors que sont les autres régions du pays ?) n’ont jamais bénéficié de travaux d’aménagement et ne possèdent ni éclairage public, ni chaussée goudronnée. Les locataires de ces constructions individuelles (c’est-à-dire les villas) pataugent dans la boue à chaque fois qu’il pleut, se plaignent aussi de l’absence de conduites de gaz et, dans certains cas, d’eau potable. Et, à cause de cela, nos villes sont devenues des agglomérations rurales où rien n’est construit selon les normes urbanistiques et les règles architecturales. Nous avons perdu le sens du beau.
Nous sommes allés vers le «clinquant» et le «mastoc». Imaginez des quartiers qui poussent confusément. Aucune esthétique ! Du n’importe quoi dans ces endroits qui ne ressemblent à rien ! De grandes villas s’érigent dans des décors étrangement fantasques où tous les styles se mêlent inégalement, irrégulièrement, disproportionnellement et où les normes sont complètement bousculées, bafouées, voire outragées. A les scruter, nous avons cette impression de l’«inachevé». De nombreuses et gigantesques bâtisses sont entassées, pêle-mêle, avec cette particularité : elles sont toutes inélégantes, affreuses et… très froides. Elles forment, à l’ombre du silence de l’autorité, de nouvelles cités qui, vues de loin, ressemblent à des favelas ou, pour être bien dans notre espace, à des «gourbivilles». Elles ne répondent à aucune esthétique, à aucun style connu dans la vaste panoplie des styles architecturaux. On dirait qu’on a créé des «regroupements» en guise de quartiers résidentiels, ces regroupements où le nombre de garages, pardon de «rideaux», comme on se plait à les désigner, dépassent l’imagination. Tous les rez-de-chaussée de ces bâtisses sont réservés pour des négoces, notamment de matériaux de construction, de gros et demi-gros, de pièces de rechange et, inévitablement, de restauration rapide… dans ces minables fast-foods qui sont loin d’être propres et à bon marché.
Ainsi, dans ces nouveaux quartiers, nous sentons l’odeur de l’imparfait, du grossier, de l’indéfini et du médiocre. Un mélange insoutenable de formes, de couleurs et d’agencements. A côté d’une construction qui manque de cohérence, avec sa façade d’école orientale, ses portes et fenêtres taillées dans le seizième siècle et ses balcons arrondies et soutenues par des colonnes corinthiennes, soulevées d’un dôme pareil à ceux de nos anciennes mosquées, une construction qui représente l’archétype de l’insolite et du baroque, s’érige une autre, en un bloc moderne, majestueux, mais sale à cause de la poussière qui colle à ses vitres qui n’ont jamais eu l’occasion d’être nettoyées. Plus encore, et bien souvent, dans les nouveaux quartiers, qui poussent à l’envi, l’on voit des monstruosités qui nous coupent le souffle. A côté d’un magasin d’articles de beauté, juste à côté, il y a un atelier de vulcanisation si ce n’est de mécanique générale, où quelques carcasses de voitures, en attente d’être réparées ou complètement dépecées, encombrent le trottoir et laissent peu d’espace à d’éventuelles clientes pour rejoindre le royaume de leur rêve. Cela nous renvoie à cette image insolite de la mariée, vêtue d’une belle robe blanche mais chaussée d’une paire de tennis, comme si elle devait se produire à Wimbledon. Nos villes ne sentent plus l’air du temps, ce temps où le trottoir était un trottoir, convenablement dallé, où la chaussée n’était pas défoncée et ne ressemblait pas à ce chemin cahoteux. Nos villes ne sont plus comme avant lorsque le jardin était encore joliment aménagé et embaumait l’atmosphère de mille senteurs, où la rue propre et accueillante n’avait pas les murs lézardés et badigeonnés de graffitis.
Nos villes ne sont plus ces cités où il faisait bon vivre, ces agréables cités qu’on appelait «Alger la blanche» ou «la ville des Roses», par exemple. Nos villes se sont imprégnées d’une autre culture, celle où dominent la saleté, la crasse et la dégradation. Notre environnement n’était pas fait de nids de poussière, il n’était pas pitoyablement hostile et rébarbatif comme celui d’aujourd’hui où «les maisons sont inachevées, tout comme le pays, où les cieux sont incapables de se maintenir en altitude», où le sachet en plastic remplace les fleurs et les tas d’immondices succèdent à ces magnifiques pyramides de fruits de saison que construisaient délicatement des marchands encore soucieux du respect de leur clientèle. Oui, notre environnement n’était pas clochardisé, comme maintenant. Il ne nous offrait pas ces images pitoyables où poussent des bidonvilles «bétonnés» en guise de nouvelles cités. De l’inconscience, diraient plus d’un qui cultivent le goût du beau et de la modération. De plus, de nombreux bâtiments se construisent sur des terrains mal choisis, mal viabilisés… des bâtiments qui sortent directement de la terre glaise, sans rebords ni trottoirs, sans contours et sans équipements socioculturels, mais ils poussent quand même parce qu’il faut abriter des gens, dans ces ensembles moroses, sans esthétique et sans âme, qui deviennent des cités-dortoirs. C’est comme cela que de nouveaux quartiers s’érigent, très vite mais sans goût, et où rien n’appelle à la sérénité, au calme et à l’harmonie. Bonjour les problèmes de promiscuité et bonjour le délabrement, la morne et la mélancolie. Des cités d’urgence, pareilles à celles que construisaient les colons pour parquer «le bas peuple» et «ceux de la montagne», qui fuyaient, selon eux, le diktat des «fellagas». Entre-temps les responsables, tout contents, présentent complaisamment des bilans pompeux à l’autorité centrale.
Certains ne vont pas de main molle. Ils gonflent les chiffres et les entourent de toute leur autosatisfaction pour plaire «en haut». Mais «en bas», chez les bénéficiaires, ce n’est pas la fête au village. C’est plutôt la grogne car ils s’aperçoivent que rien n’a été fait selon les normes de la bonne architecture et les règles de l’urbanisme. Tout est faux dans ces cités qui ne servent qu’à dormir, parce que pour y vivre, convenablement et décemment, comme les gens civilisés… c’est trop dire ! Quand il y a de l’électricité, il n’y a pas d’eau et quand il y a de l’eau – par miracle disent les locataires – il n’y a pas d’électricité et autres commodités, les plus indispensables. Une sacrée mascarade que ces programmes de logements qui s’appliquent essentiellement pour le nombre au détriment de la qualité. De toute façon, cela ne dérange aucunement les responsables tant que les bénéficiaires sont considérés comme des moutons. Qu’ils soient dans cette bergerie ou dans une autre, étroite et sans confort, ce ne sont que des moutons. Les autres, les plus nantis habitent bien, et c’est l’essentiel. Pour ne pas rester dans les généralités, je cite un exemple d’une de nos communes les plus importantes et qu’on traverse souvent, lors de nos voyages, à l’ouest du pays. Ainsi donc, celle-ci offre un visage défiguré aux visiteurs. En effet, écrivait un journaliste, aux abords de cette route traversée quotidiennement par quelques milliers de voitures, plusieurs entreprises de construction y sont implantées ainsi que des commerces de mécanique auto, dont les utilisateurs et les gérants s’approprient les espaces en déversant toutes sortes de déchets liés à leurs activités.
Quel spectacle dans cet environnement insolite ! Ainsi, c’est le massacre des parcelles de terre et des arbres qui supportent sur leurs branches ou au pied de leur tronc des pneus et autres objets généralement en métal. Par ailleurs, sont accrochées sur des arbres, en plein centre-ville, des poubelles nouvellement acquises par les pouvoirs publics. Également, les regards bouchés dans plusieurs quartiers où les eaux stagnantes font craindre le pire, en période de grande canicule, ne font bouger personne. Cette situation ne semble pas émouvoir les responsables pas plus que les citoyens qui se sont habitués à vivre dans ce décor bizarre et étrange, pire encore, «merdique» et dégradant. Mais que voulez-vous ce n’est pas tout le monde qui a connu la propreté et la discipline. J’ai encore une autre description pour une autre ville de la même région. En fait, c’est tout le pays qui est comme cela. Il n’y a pas un léger mieux quelque part qui puisse nous concéder cette certitude que demain tout ira mieux. C’est le visage de toutes nos communes et de nos grandes villes qui accusent une dangereuse régression, doublée d’une périlleuse clochardisation. Et, au hasard de mes lectures, je découvre ce papier qui confirme que nous ne prenons pas soin de notre environnement qui souffre déjà de mille et un affronts que nous lui faisons tous les jours.
(A suivre)
Par Kamel Bouchama (auteur)