Taha Abderrahmane lecteur de Saïd Nursî et d’Emmanuel Levinas (II)
Sophisme
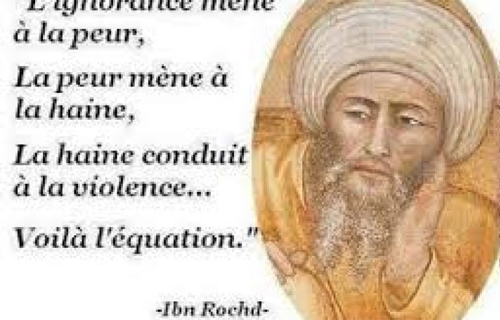
Le nouveau Saïd Nursî : le sage. Qui est le nouveau Badî’u Az-Zamân ? Il incombait donc au nouveau Saïd «de faire le ménage dans sa pensée et la débarrasser des souillures de la philosophie enjolivée et des pollutions de la civilisation faible d’esprit «(Al-Lama’ât, p. 176). Qui l’a sorti de cet égarement manifeste ? «Alors que j’étais dans cet état [de pollution intellectuelle], la sagesse sacrée du Coran me vient en aide, par Miséricorde du Très-Haut, le Puissant, par Sa mansuétude, gloire à Lui. Et j’ai alors lavé les saletés de ces questions philosophiques «(Al-Lama’ât, 367-368).
Quelle est désormais la méthode adoptée par le nouveau Saïd ? Selon T. Abderrahmâne, à l’aide de trois critiques, Saïd Nursî s’est mis à rejeter l’interpénétration et la coexistence de la philosophie et de la sagesse : «La critique logique», «la critique morale et «la critique allégorique». Par exemple, la critique allégorique consiste à comparer le philosophe à celui qui emprunte un «tunnel» ou une caverne, alors que chez Platon c’est l’ignorant qui se trouve dans la caverne et le philosophe est le clairvoyant, comme chez Descartes d’ailleurs. Etonnamment, deux philosophes sont cités à plusieurs reprises par Saïd Nursî pour illustrer cet égarement : Ibn Sina, Al-Farabi et leur «philosophie naturelle». Quant à la critique morale, sans être exhaustif, il est reproché notamment à la philosophie son incapacité à sonder les «secrets de l’unicité» et sa focalisation sur «le moi». Plus généralement, Saïd Nursî le sage adopte «le principe de la fondation de la raison (Al-’Aql) sur la tradition (An-Naql)» et «le principe du recours aux textes et à la tradition dans les questions rationnelles». C’est donc l’inverse de ce que faisait l’ancien Saïd, le philosophe. D’où la distinction de Badî’u az-Zamân I (l’ancien) et Badî’u az-Zamân II (le nouveau).
Et cette révolution intellectuelle s’explique peut-être par cette révolution politique et sociale turque sous l’effet des bouleversements des sociétés occidentales. Des bouleversements qui s’expliquent par la révolution intellectuelle de la philosophie moderne contre la sagesse religieuse, dont l’illustre représentant est justement le philosophe E. Kant, estime T. Abderrahmane : «Si Kant a fait de la philosophie une alternative à la sagesse en cas de leur opposition, Badî’u az-Zamân fait de la sagesse un substitut de la philosophie en cas de leur opposition» (T. Abderrahmane, Question de méthode, 2015. p. 189-190). Et d’ajouter que cette contradiction entre le rôle de la raison dans l’alliance entre philosophie et sagesse, d’une part, et le réel politique et social déviant, de l’autre, a poussé Badî’u az-Zamân à revoir sa vision philosophique. D’où «la mort de Badî’u az-Zamân le philosophe et la naissance de Badî’u az-Zamân le sage» (T. Abderrahmane, Question de méthode, 2015. p. 174).
Taha Abderrahmane lecteur critique du philosophe Emmanuel Levinas
Dans un élan d’exaltation quelque peu hâtif, Philippe Nemo écrit ceci : «Emmanuel Lévinas est le philosophe de l’éthique, sans doute le seul moraliste de la pensée contemporain» (Éthique et infini, p.7). Pourtant, Taha Abderrahmane est surtout connu pour sa philosophie morale, ou si vous voulez, la philosophie de l’éthique. Et il n’est donc pas étonnant qu’il se soit livré à la lecture critique des philosophes qui ont traité de cette même thématique, ce qu’il a fait notamment de l’approche d’Emmanuel Levinas à propos de La question de la violence (2017, 215 pages), l’un de ses derniers ouvrages. Il y expose sa propre philosophie morale en rapport avec le phénomène de violence. C’est sa lecture critique du philosophe franco-lituanien (qui tient environ en 20 pages seulement) que nous allons restituer dans cette section. Pour T. Abderrahmane, le dialogue n’est pas un simple discours, il constitue son fondement. De même qu’il n’y a pas de dialogue sans société, il n’y a pas de société sans morale, ni de morale sans responsabilité. Or, selon T. Abderrahmane, la notion de responsabilité diffère selon que l’on se situe dans la perspective biblique ou coranique : «Où est ton frère Abel ? Il répondit : «Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» (Genèse, 4). «Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d’Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes : «Ne suis-Je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent : «Mais si, nous en témoignons… «– afin que vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection : «Vraiment, nous n’y avons pas fait attention» (A’arâf, 172).
Deux déductions majeures en résultent. La première est que dans la perspective biblique, la responsabilité correspond à la «muwâjaha», un face-à-face, c’est-à-dire que l’Homme est questionné sur son devoir, il en rend compte, il doit répondre de quelque chose ; alors que dans la perspective coranique, la responsabilité correspond à la «muwâthaqa», du verbe «wâthaqa» c’est-à-dire sa parole donnée, son engagement scellé, c’est une responsabilité dans laquelle l’Homme est questionné sur son engagement antérieur. La deuxième déduction qui découle de la première est que la responsabilité dans l’approche coranique repose sur la «amâna» (un dépôt à préserver soigneusement) et le «tathakkur», le rappel du fondement religieux de cette responsabilité ; tandis que dans la perspective biblique elle repose sur le «tanakkur», puisque le face-à-face implique le «reniement» du fondement religieux du devoir, et comme nous allons le voir chez Levinas, du fondement religieux de l’éthique. C’est ce qu’il appelle dans un autre ouvrage majeur (L’esprit de la religion) «attaghyîb», l’invisibilisation, l’Homme s’élève au rang du divin, dans le monde de l’invisible. Quant à la perspective islamique, la responsabilité repose sur «attachhîd», la visibilisation, puisque l’Homme réalise le fondement divin de la morale dans le monde visible. Ces propos liminaires sont nécessaires puisque la philosophie d’Emmanuel Levinas puise ses fondements essentiellement dans les études bibliques et talmudiques.
Quels sont alors les grands traits de sa philosophie et, surtout, qu’en pense le philosophe T. Abderrahmane ? Emmanuel Levinas entreprend de chercher le sens de l’éthique, ou de déterminer les conditions qui la rendent possible. A cet effet, il se réfère à une philosophie du dialogue en tant qu’éthique, un dialogue qui, tout en étant dans la séparation et la «distance», est une «relation de face à face» (E. Levinas, Totalité et infini, p. 29). Toutefois, le fondement de l’éthique n’est plus ce moi qui traditionnellement persévère à rebours de ses passions et de sa «nafs», ou tend vers la perfection et la purification de son âme, ou obéit à la loi, ou approfondit la contemplation et la méditation, ou cherche à intensifier sa spiritualité… rien de cela. Le fondement de l’éthique chez Levinas réside désormais dans l’Autre, l’Autrui. On a ici une primauté de l’Autre par rapport au moi, c’est en ceci que l’éthique précède l’ontologie et devient chez Levinas la «philosophie première» par excellence. Et la «meilleure manière de rencontrer autrui, c’est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux (…) autrui n’est pas un personnage dans un contexte» (E. Levinas, Éthique et infini, p. 79-80). Il ne s’agit pas d’une relation sociale, mais d’une «relation métaphysique» (Totalité et infini, p. 32), où «la manière dont se présente l’Autre, dépassant l’idée de l’Autre en moi, nous l’appelons, en effet, visage» (Totalité et infini p. 43).
En quoi consiste le concept de visage chez Levinas qui représente l’Autre? L’autre se manifeste au moi par le visage. Pour lever toute confusion, précisons que le «visage n’est pas de l’ordre de la perception pure et simple» (Éthique et infini, 92), ce n’est pas ce qui apparaît à la vision, et il est sans contexte car «il est sens à lui seul», ni notre pensée pourrait le contenir. C’est ce qui fait de l’accès au visage une relation à la fois éthique, métaphysique et asymétrique. En effet, «le» Tu ne tueras point «est la première parole du visage» (Éthique et infini, p. 83). Le visage ordonne, et cet ordre est la signifiance même du visage, écrit Levinas. Et le moi n’est jamais quitte envers autrui, quels que soient les quantités d’actes vertueux envers l’autre. Mais, s’il est «élévation», «hauteur», «transcendance» et lieu de «l’Infini», ce visage demande dans le même temps, il est «dénué», «pauvre», «exposé», «faible», «menacé», «sans défense», susceptible d’être l’objet de ma «violence». On peut d’ores et déjà pressentir le malaise que peut éprouver un spécialiste de la morale et du langage comme Taha Abderrahmane face à cette philosophie. Il s’est longuement consacré à l’éthique, notamment dans La question de la morale, 2000. Dans son commentaire de l’éthique d’Emannuel Levinas, Taha Abderrahmane écris : «Nous avons défini le concept de «attaghyîb» (invisibilisation) par «attanakkuriyya» (reniement) qui attribue les qualités divines, invisibles à l’œil et inaccessibles à la raison, à l’Homme, l’élevant au rang de Dieu» (La question de la violence, p. 185).
Il distingue plusieurs degrés de taghyîb, le plus faible est celui qui accorde à l’Homme les noms des actes de Dieu, ensuite les noms de Ses attributs, enfin les noms de son essence, et c’est le degré «le plus odieux», écrit T. Abderrahmane. Il ajoute que cette élévation au rang de Dieu ne signifie pas que les qualités humaines sont abrogées, si bien que Dieu se voit attribuer des qualités humaines ! Or, aux yeux de T. Abderrahmane, Levinas pratique le «taghyîb» dans le cadre du dialogue. En effet, les adjectifs attribués par Levinas à la relation entre le moi et l’autre décrivent habituellement la relation entre l’Homme et Dieu. Pour levinas, l’autre est séparé du moi et transcendance, autant de qualités divines. C’est ainsi que l’autre entre dans le cadre de l’invisible qu’aucun homme ne peut atteindre. Il s’agit plus précisément selon T. Abderrahmane d’une invisibilisation du deuxième degré, à savoir que les attributs de Dieu sont attribués à l’autre : Al-mubâyana, atta’âlî, allâtanâhî, al-itlâq (=la séparation qui marque une distance, la transcendance, l’infini, l’absolu) (La question de la violence, p. 186-187). De même, il lui arrive d’identifier Dieu à l’autre sans distinction, comme s’ils constituaient un seul être (Levinas, Envers Autrui in Quatre lectures talmudiques, éditions de minuit, 1968, p. 36, cité par T. Abderrahmane). Si «le visage est le lieu où Dieu se révèle», le «transcendant est posé comme étranger et pauvre» (Totalité et infini, p. 76). «Le visage est seigneurie et le sans défense même (…).
Il y a dans le visage la suprême autorité qui commande, et je dis toujours, c’est la parole de Dieu» (Altérité et transcendance, p. 114). En outre, T. Abderrahmane constate que «le concept de visage est habituellement abordé dans les livres révélés comme étant Dieu lui-même», c’est ainsi que Levinas, empruntant ce concept aux livres révélés, a invisibilisé l’autre en le désignant par l’un des noms de l’essence de Dieu, et il n’y a pas une invisibilisation plus obscène que celle-ci (La question de la violence, p. 188). Il n’est d’ailleurs pas étonnant de voir Levinas parler à plusieurs reprises «d’épiphanie du visage». Quant au premier degré d’invisibilisation, à savoir attribuer les noms des actes de Dieu aux hommes, il apparaît dans le concept de (Attajallî) «manifestation» cher à Levinas : «Ce n’est pas une» manifestation au sens de «dévoilement», qui serait adéquation à une donnée. Le propre, au contraire, de la relation à l’Infini, c’est qu’elle n’est pas dévoilement (Éthique et infini, 102).
Pour finir, T. Abderrahmane traite de ce qu’il appelle «taghyîb allugha», l’invisibilisation du langage chez E. Levinas. Puisque la relation entre le moi et l’autre ou le visage médiatisée par le discours, c’est que le discours lui-même s’inscrit logiquement dans le même cadre métaphysique, il ne relève pas d’un savoir que l’on pourrait appréhender «de même que Dieu se manifeste par sa Parole adressée à l’Homme, le visage de l’autre se manifeste par son discours adressé au moi. De même que la parole de Dieu exprime des ordres qui exigent obéissance, illustrée par les dix commandements, le discours de l’autre appelle obéissance, illustré par l’un des commandements, comme «Tu ne tueras point» «(La question de la violence, p. 190-191). La seule possibilité qui nous reste c’est de nous contenter des «traces» du discours en tant que «signe». Ceci devrait nous aider à comprendre «le secret dans sa mise en relation de la religion et de l’athéisme», écrit Taha Abderrahmane. «Se rapporter à l’absolu en athée, c’est accueillir l’absolu épuré de la violence du sacré (…). Seul un être athée peut se rapporter à l’Autre et déjà s’absoudre de cette relation (…). L’athéisme conditionne une relation véritable avec un vrai Dieu» (Totalité et infini, p. 75). Qu’en est-il de l’approche islamique qui repose, à ses yeux, sur la muwâthaqa et la amâna ? L’ouvrage de Taha Abderrahmane répond à cette question.
(Suite et fin)
Jaroui Mouhib










